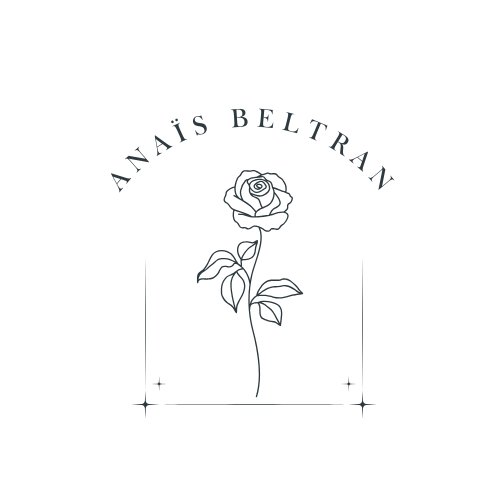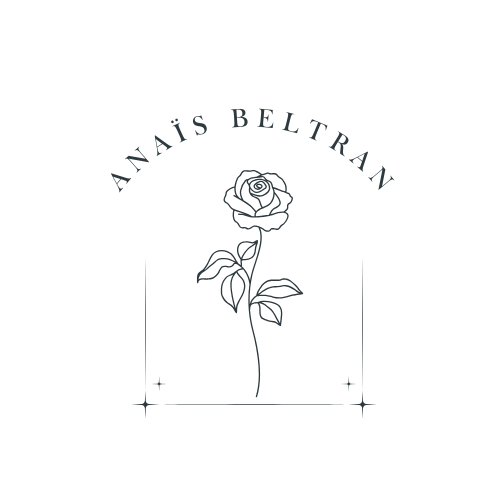Daisugi : une leçon ancestrale japonaise pour préserver nos forêts
Le Daisugi : Un Art Ancestral de Gestion & d’harmonie Forestière au Japon
Chemin de sapinière des Vosges, @Fabrice Lalloz
Je vis dans les Vosges du Sud, née sous l’oeil du Lion de Bartholdi à Belfort. Cette ville assez verte de Franche-comté est située à vingt minutes des forêts vosgiennes féériques, profondes et puissantes qui s’étendent sur la Haute-Saône, l’Alsace et le Territoire de Belfort. Pour moi, la forêt n’est pas qu’un décor ou un loisir, elle est mon poumon, mon refuge, mon temple vivant, une partie de moi-même. C’est dans ces forêts que j’ai vécu certaines de mes initiations chamaniques, que je me suis ouverte aux enseignements mélodieux des arbres centenaires, des rivières et des pierres de mousses, des animaux et du petit peuple. Aujourd’hui, la fréquence vibratoire de la Terre en mutation rend le dialogue avec le vivant plus sensible, plus clair, intense et immédiat, malgré le silence apparent. La vibration est plus palpable. Les initiations sont plus profondes, comme si les énergies elles-mêmes s’actualisaient à toute vitesse, permettant une intégration plus rapide et une perception plus fine. Les frontières entre le visible et l’invisible s’amenuisent. Ce qui était autrefois ressenti dans l’intuition se manifeste avec une évidence troublante. La forêt n’est plus seulement un lieu d’ancrage, elle devient un espace de transformation accéléré, un portail où le temps s’étire et où la mémoire du vivant s’offre sans filtre. Comme si la nature, impatiente, murmurait plus fort qu’avant et qu’elle était prête à s’offrir à quiconque se mettrait en posture de réceptivité sincère depuis le coeur. Un immense terreau de richesses insoupçonnées et de transformation pour l’être humain, à préserver et mieux “gérer”, en nous inspirant des techniques de coupe japonaises plus respectueuse des arbres maîtres et plus sensibles au vivant !
Photographie de l’artiste Fabrice Lalloz, un ami qui sait capturer la magie des Vosges à merveille
Personnellement, ce lien “viscéral” avec la forêt ne date pas d’hier. Il est tissé dans mon enfance, dans ces souvenirs où ma grand-mère, ma mère et mes tantes nous embarquaient, à chaque instant libre, pour de longues balades en forêt. Dès que l’école s’arrêtait, c’était direction les sous-bois, à marcher, observer, sentir, écouter. J’ai grandi en forêt, je m’y suis formée bien avant même de savoir que c’était une transmission.
Même aujourd’hui, dans la ville où je suis née et où je vis, j’ai cette chance d’avoir une petite forêt à proximité, un espace sauvage au cœur de l’urbain, une ressource vivante qui me permet d’honorer cette connexion quotidienne avec la nature. Quand je n’ai pas le temps d’aller dans les Vosges, je plonge dans ce bois familier, je mange du sauvage presque tous les jours. Je me sens un peu désoeuvréé de voir beaucoup d’arbres tomber à terre par la sécheresse, et souvent des plantes sauvages précieuse à la biodiversité, arrachées par les faucheuses de la ville.
Trésor urbain rempli des meilleures nourritures comestibles et médicinales : Orties, feuilles d’arbres, rosiers sauvages et cynorhodons, gémmothérapie de bourgeons d’arbres et d’arbustes, ail des ours, thés fermentés de feuilles de mûrier et de framboisier, écorces récoltées avec soin… C’est ici aussi que je fabrique mes crayons à fusain, que je trouve les plantes pour créer des remèdes médicinaux : aubépine, glands de chêne, marjolaine sauvage, millepertuis… Cette forêt est un livre vivant, un dispensaire naturel, un laboratoire à ciel ouvert.
Quand j’étais enceinte, c’est ici que je venais marcher chaque jour. Je savais que chaque pas, chaque respiration nourrissait aussi mon bébé, que la forêt avait cette capacité à transmettre une force invisible.
Ce qui me fascine aussi, en plus de la vue imprenable sur les Vosges au sommet, c’est la diversité de cette forêt : des sols humides, mais aussi des terrains plus secs aux notes méditerranéennes dans une région du nord-est de la France.
Cette forêt de proximité à la ville, et la manière dont je l’ai “sanctifiée” en l’intégrant complètement à mon quotidien, se rapproche du rapport entre nature et humain au Japon. Là-bas, même en ville, la nature est intégrée, elle fait partie du paysage mental autant que du territoire physique. Les Japonais vénèrent leurs arbres, ils vouent des cultes aux éléments, et dans leur quotidien citadin, ils entretiennent ce lien avec le vivant. Pourquoi n’en serait-il pas de même ici ?
Dans mon métier et dans mes transmissions, il me tient à coeur de rappeler aux personnes citadines que même s’ils sont connectés à la ville, ils peuvent se nourrir du sauvage par petits prélèvements. On ne soupçonne pas à quel point ces espaces sont des trésors : nourriture, médecine, art, ancrage, initiation chamanique. Il suffit d’ouvrir les yeux. J’ai aussi vécus des initiations très puissantes avec des arbres en plein coeur de Paris !
Bien sûr, il y a des plantes protégées, et il est essentiel de respecter les réglementations locales. Mais dans la majorité des cas, il est tout à fait possible de récolter, de cueillir, d’entrer en dialogue avec la nature, même en milieu urbain car beaucoup de ressources végétales poussent naturellement et ne sont pas traitées chimiquement.
C’est dans cet état d’esprit que je souhaite vous parler de la technique du Daisugi, née au Japon il y a plusieurs siècles, car elle me semble être une approche “constructive” à intégrer dans nos gestion forestières et écologiques urbaines. Parce qu’elle incarne ce que la mondialisation pourrait être dans sa part de lumière : non pas un rouleau compresseur qui écrase les traditions locales, mais un tissage des savoirs ancestraux, une inspiration mutuelle pour régénérer nos terres, où qu’elles soient.
La technique ancestrale du Daisugi, un paysage presque fantaisiste venu d’un autre monde.
Les Japonais ont su cultiver les arbres sans les détruire, en développant une méthode de coupe respectueuse et durable. Pourquoi ne pas s’en inspirer pour repenser nos forêts françaises ?
Origine et Histoire du Daisugi
Cette technique est née au Japon en réponse à la demande croissante de bois de haute qualité pour la construction de maisons et de temples. À l’époque Muromachi, Kyoto était un centre de raffinement esthétique, où l’architecture des maisons de thé et des temples zen nécessitait du bois parfaitement droit et sans défauts. Cependant, l’espace étant limité et le sol rocailleux dans certaines zones, les artisans ont développé cette méthode pour produire du bois de construction de manière plus efficace et sur une surface réduite.
Le Kitayama Sugi, cèdre spécifique de la région, a été favorisé pour cette technique en raison de sa croissance droite et de sa qualité de bois fine et dense. Aujourd’hui, le daisugi est encore pratiqué mais reste un savoir-faire rare, perpétué par quelques forestiers spécialisés.
En quoi consiste la technique du Daisugi ?
Le daisugi suit un processus de taille spécifique qui transforme un arbre en une véritable plateforme vivante :
- Sélection du cèdre mère : On choisit un jeune cèdre sain et robuste, qui servira de base pour les futures pousses.
- Taille drastique : On coupe les branches latérales et ne garde que quelques pousses verticales, qui grandiront comme des troncs secondaires.
- Entretien rigoureux : Tous les 2 à 4 ans, les branches latérales sont élaguées pour favoriser la croissance droite des nouvelles pousses.
- Récolte : Après 20 à 30 ans, les troncs secondaires atteignent une hauteur et une rectitude idéales. Ils sont coupés sans abattre l’arbre mère, qui continue de produire de nouveaux troncs.
- Durée de vie de l’arbre : Un seul arbre peut ainsi produire du bois pendant plus de 200 à 300 ans, limitant la déforestation et maximisant l’usage du sol.
Avantages et Intérêt de Réintroduire le Daisugi en Europe
Actuellement, la déforestation et la surexploitation des forêts posent de sérieux problèmes. Le daisugi pourrait inspirer une gestion forestière plus respectueuse et durable.
- Utilisation optimisée du sol : Permet une meilleure production de bois sur une petite surface, idéal pour les zones où l’espace est limité.
- Préservation des arbres mères : Contrairement aux coupes rases, cette technique permet aux arbres de rester vivants et d’être productifs sur plusieurs siècles.
- Réduction de l’érosion des sols : En maintenant le système racinaire en place, on évite les glissements de terrain et la perte de biodiversité associée aux coupes traditionnelles.
- Qualité du bois exceptionnelle : Le bois issu du daisugi est plus dense, droit et résistant, parfait pour la construction et l’artisanat.
- Économie circulaire : Cette gestion raisonnée offre un modèle viable pour l’exploitation forestière sans destruction massive.
En Europe, on pourrait envisager d’adapter cette technique aux forêts de chêne, hêtre, frêne ou châtaignier, qui possèdent une capacité de repousse similaire. Elle pourrait être intégrée aux pratiques de sylviculture durable, notamment en France, où la tradition des taillis sous futaie est proche dans son concept.
L’état des forêts en Europe : Bilan et Perspectives
L’Europe possède l’un des meilleurs taux de reforestation au monde, mais la situation varie selon les pays et les pressions économiques.
- Allemagne : Un exemple de gestion forestière réussie. Environ 32% du territoire allemand est boisé, et des pratiques de sylviculture durable y sont en place depuis le XIXe siècle.
- France : Les forêts françaises ont doublé en surface depuis le XIXe siècle et représentent aujourd’hui 31% du territoire. Cependant, des défis persistent, notamment avec la surexploitation de certaines essences et la sécheresse qui fait tomber les arbres aux premières tempêtes.
- Espagne et Italie : Fortement touchées par la désertification et les incendies, en raison du réchauffement climatique.
- Europe de l’Est : Encore de nombreuses forêts primaires exceptionnelles, mais menacées par la coupe illégale et l’urbanisation.
Vers un Art de Vivre avec les Arbres Centenaires
Au Japon, des cèdres sacrés âgés de plus de 1000 ans sont vénérés et protégés. En Allemagne, des chênes centenaires sont intégrés aux traditions locales. En France, des forêts comme Tronçais ou Brocéliande sont des exemples de préservation.
S’inspirer du daisugi pourrait permettre de réconcilier économie et écologie, en préservant les forêts tout en répondant aux besoins humains. L’agroforesterie suit une logique similaire, où les arbres ne sont pas perçus comme un obstacle, mais comme des alliés pour la biodiversité et la régénération des sols.
Repenser notre Relation aux Forêts
Le daisugi n’est pas qu’une technique, c’est une philosophie : celle de cultiver les arbres sans les détruire, en travaillant en harmonie avec le vivant. En Europe, où la pression économique pousse à des pratiques intensives, cette approche ancestrale et visionnaire pourrait offrir une solution inspirante à l’exploitation forestière de demain.
Laissons-nous inspirer par cette sagesse du Japon, et prenons le temps de repenser notre lien aux arbres, à la forêt et au bois que nous utilisons au quotidien.
Anaïs Beltran