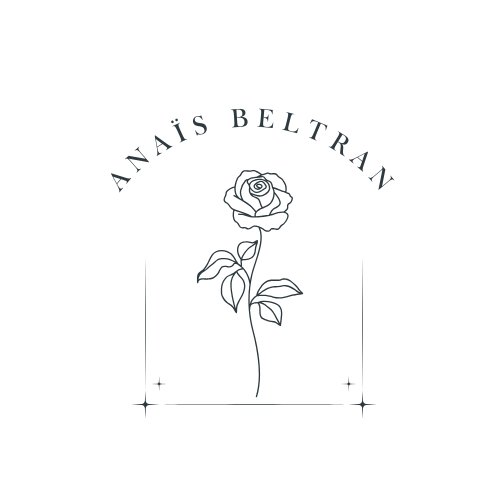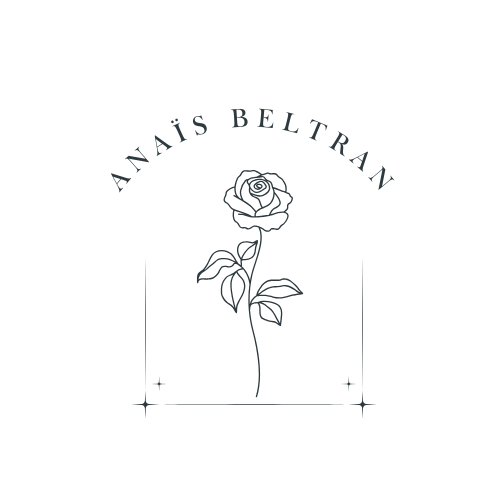L’agriculture syntropique : régénéreR, reforesteR, nourrir l’avenir
Un monde agricole à bout de souffle : quand la régression devient la norme
“Nous ne sommes pas les intelligents du système, mais faisons partie d’un système intelligent” – E.Götsch
L’agriculture en France traverse l’une des plus grandes crises de son histoire actuellement. Alors que la prise de conscience de l’urgence écologique progresse dans certains milieux, les décisions politiques récentes au Sénat, semblent marquer un retour en arrière préoccupant. Réautorisation de pesticides destructeurs, affaiblissement des normes environnementales, mise en péril de la biodiversité – autant de signes qui montrent que nous reculons au lieu d’avancer.
Pendant ce temps, le monde agricole souffre. Endettement massif, dépendance aux intrants chimiques, pression des grandes industries agroalimentaires, tout cela a conduit les agriculteurs à une précarité inacceptable. Même ceux qui ont suivi le modèle productiviste ne s’en sortent pas. Ils travaillent d’arrache-pied sur des terres appauvries et empoisonnées, pris au piège d’un système qui ne les nourrit plus, ni financièrement, ni humainement. Ce constat amer pousse aujourd’hui de plus en plus de personnes à chercher des alternatives viables, respectueuses du vivant et capables d’offrir une vraie autonomie aux agriculteurs. Parmi elles, je souhaitais aborder dans ce nouveau billet de blog, un modèle encore trop méconnu qui se distingue également de la permaculture et que j’ai découvert il y a 1 an à Ibiza : la syntropie.
La Syntropie : une agriculture qui imite la forêt et régénère le vivant
Je vous partage cette vision philosophique plus large de la syntropie qui m’a frappé, sur le site de la fondation “Destination Syntoprie” :
“L’agriculture syntropique, c’est d’abord et avant tout un changement de perspective. Il s’agit d’une nouvelle proposition de lecture de l’écosystème, qui utilise un autre raisonnement basé sur la coopération et l’amour inconditionnel comme moteur de l’interaction entre espèces. L’agriculture syntropique traduit les processus naturels en interventions agricoles, et invite ainsi l’Humain à retrouver une place juste et bénéfique au sein du Vivant.”
Cette pratique d’agroforesterie successionnelle existerait déjà depuis bien longtemps : les peuples premiers utilisaient des pratiques agricoles similaires il y a déjà quelques milliers d’années.
La syntropie, ou agriculture syntropique, est un modèle agricole inspiré des écosystèmes naturels, qui imite le fonctionnement des forêts pour produire de manière durable. Contrairement à l’agriculture conventionnelle, qui épuise les sols, et même à la permaculture, qui vise principalement à stabiliser des systèmes agroécologiques, la syntropie cherche à enrichir et restaurer continuellement la terre tout en produisant de la nourriture en abondance.
D’où vient la syntropie ?
Ce concept a été développé par Ernst Götsch, un agriculteur et chercheur suisse installé au Brésil. À travers ses expériences, il a démontré qu’il était possible de cultiver des terres dégradées en recréant des systèmes naturels auto-fertiles basés sur la dynamique des forêts tropicales. En intégrant des cultures agricoles dans des successions naturelles de plantes, il a prouvé que l’agriculture pouvait être non seulement durable, mais aussi régénératrice.
“Une évolution syntropique est une force qui pousse les systèmes vivants vers des niveaux de plus en plus élevés d’organisation, d’ordre et d’harmonie dynamique.", contrairement à l’entropie qui établit que tout système clos tend à la simplification et au désordre.
Syntropie vs Permaculture : quelle différence ?
Bien que la syntropie et la permaculture partagent des bases communes (respect du sol, polyculture, biodiversité), elles se distinguent sur plusieurs points :
L’approche temporelle et dynamique : la syntropie ne cherche pas seulement à imiter la nature dans son état stable, mais aussi dans son évolution dynamique. Elle reproduit les successions écologiques, c’est-à-dire l’ordre naturel dans lequel les plantes apparaissent et se remplacent dans un écosystème.
Une interaction volontaire avec l’environnement : alors que la permaculture tend parfois à privilégier des systèmes en équilibre stable, la syntropie encourage une gestion active, en taillant, en stimulant certaines plantes, et en favorisant leur synergie pour créer un sol de plus en plus riche au fil du temps.
Un sol qui s’enrichit en continu : la syntropie ne nécessite pas d’apport extérieur massif de compost ou d’engrais, car le système génère lui-même sa propre fertilité, en s’appuyant sur la décomposition naturelle des végétaux et les interactions entre espèces.
Un modèle qui va plus loin que l’autosuffisance : la permaculture est souvent associée aux petites fermes autonomes, alors que la syntropie vise aussi les grandes cultures et la reforestation de terres appauvries, montrant qu’un modèle agricole à grande échelle peut être viable sans chimie.
Techniques clés de la Syntropie : comment recréer un écosystème agricole auto-fertile
L’agriculture syntropique ne se contente pas d’imiter la nature, elle accélère et optimise les processus de régénération que l’on observe dans les écosystèmes naturels. Voici quelques techniques fondamentales utilisées dans cette approche :
La succession écologique planifiée
Dans une forêt naturelle, les plantes apparaissent selon un cycle logique :
• Les pionnières (herbes, légumineuses, arbustes à croissance rapide) viennent stabiliser le sol et capter l’azote.
• Les intermédiaires (fruitiers, arbustes vivaces) prennent ensuite le relais.
• Les espèces dominantes (grands arbres et cultures pérennes) finissent par structurer le paysage.
En syntropie, on plante ces différentes catégories ensemble, dès le départ. Chaque plante joue un rôle et prépare la transition vers l’étape suivante.
Exemple concret :
Si on veut cultiver des arbres fruitiers sur un sol dégradé, on ne plante pas juste des pommiers. On ajoute :
Des légumineuses pour fixer l’azote (luzerne, féverole).
Des herbacées et arbustes à croissance rapide qui protègent le sol (sorgho, manioc, topinambour).
Des arbres de transition (acacias, chênes) qui créeront un microclimat protecteur.
Les plantes se succèdent naturellement, enrichissent le sol et se remplacent les unes les autres sans intervention brutale.
L’agroforesterie dynamique
Plutôt que de planter en lignes monospécifiques (comme en permaculture classique), la syntropie imite les strates d’une forêt :
Canopée haute : Grands arbres fixateurs d’azote, arbres fruitiers (châtaigniers, noyers, pacaniers).
Sous-canopée : Arbres fruitiers intermédiaires (pêchers, pruniers, kakis, avocatiers).
Arbustes et vivaces : Petits fruitiers (framboisiers, cassissiers, goyaviers).
Couche herbacée : Légumes, plantes médicinales (basilic sacré, orties, consoude).
Couverture du sol : Plantes qui étouffent les adventices et protègent l’humidité (trèfle blanc, patate douce, courges).
Pourquoi ça marche ?
Pas de compétition mais de la coopération : chaque plante remplit un rôle, elles se protègent et s’enrichissent mutuellement.
Moins d’entretien : le système devient autosuffisant en fertilité et en gestion de l’eau.
La taille et le mulching intensif (chop and drop)
En forêt, les feuilles tombent au sol et créent un circuit continu de fertilisation.
En syntropie, on taille régulièrement les plantes secondaires (ex : bananiers, légumineuses, arbres de transition) et on laisse les déchets sur place pour enrichir le sol.
Avantages :
Création rapide d’humus pour améliorer la fertilité.
Conservation de l’humidité, limitant l’irrigation.
Protection contre l’érosion et le lessivage des sols.
La gestion de l’eau et du microclimat
L’eau est optimisée naturellement grâce à plusieurs stratégies :
Création de microclimats :
En plantant en densité et en hauteur, l’humidité est piégée et les plantes restent protégées des extrêmes climatiques.
Utilisation des couverts végétaux et du mulch : cela évite l’évaporation et maximise l’absorption des précipitations.
Aménagements en courbes de niveau : des techniques comme les baissières (swales) sont utilisées pour ralentir l’écoulement de l’eau et la stocker dans le sol.
En appliquant ces principes, on peut cultiver des fruits et légumes même en zones arides ! J’ai eu le plaisir de découvrir cette philosophie agronomique en zone aride à Ibiza l’année dernière, avec le collectif “Tierra Iris” et sa ferme qui pratique la syntropie. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, une retraite immersive annuelle de certification en agroforesterie syntropique aura lieu sur le site de Tierra Iris à Ibiza du 17 au 21 avril. Un rendez-vous unique avec l’organisme Sitio Semente, pour apprendre, expérimenter et se reconnecter à la terre dans un cadre enchanteur.
Quelles Plantes clés et exemples concrets applicables en France ?
Voici quelques plantes incontournables pour une approche syntropique sous climat tempéré :
Plantes fixatrices d’azote (fertilité naturelle du sol) :
• Luzerne, trèfle, sainfoin
• Acacia, robinia faux-acacia
• Féverole, pois chiche
Plantes de couverture (protègent et enrichissent le sol) :
• Trèfle blanc, moutarde, phacélie
• Ortie, consoude (riches en nutriments)
• Patate douce, courge
Plantes pionnières (préparent les sols dégradés) :
• Sureau noir, bouleau
• Topinambour, canne de Provence
• Sorgho, millet
Plantes de culture en strates pour un verger syntropique :
Canopée → Châtaigniers, noyers, pacaniers
Sous-canopée → Pommiers, poiriers, figuiers
Arbustes → Cassis, groseilliers, argousiers
Sol → Fraisiers, oseille, plantes médicinales
En combinant ces espèces avec la gestion dynamique des sols et de l’eau, on recrée un écosystème agricole prospère et résilient.
Pourquoi la syntropie est une solution d’avenir en France ?
La syntropie n’est pas seulement adaptée aux climats tropicaux du Brésil ou d’Afrique. En France, ce modèle peut être un atout majeur pour régénérer nos sols agricoles appauvris et recréer une résilience face au changement climatique.
Dans les régions agricoles en souffrance : la syntropie peut redonner vie aux sols dégradés en intégrant des cultures adaptées aux successions écologiques locales. Elle permet de redonner vie aux terres agricoles dégradées.
Dans les grandes exploitations : elle peut remplacer progressivement les monocultures intensives par des systèmes diversifiés et productifs.
Dans les fermes en reconversion : elle offre une alternative viable aux agriculteurs qui souhaitent sortir de la dépendance aux intrants chimiques et aux dettes.
Elle répond aux enjeux climatiques en stockant du carbone dans le sol et en limitant l’impact des sécheresses.
Plusieurs projets émergent en Europe, et la France a tout à gagner à explorer cette approche !
Il est temps de passer de l’idée à l’action ! Quand tout est foutu, tout redevient possible !
L’agriculture syntropique est bien plus qu’une alternative, c’est une vision régénératrice qui pourrait transformer notre rapport à la terre et à nous-même. Elle demande une compréhension fine des cycles du vivant, mais en retour, elle offre une production résiliente, une terre vivante, et un modèle autonome où l’être humain reprend sa juste place au sein d’un écosystème sans le dominer.
Les prochaines étapes ?
Former les agriculteurs à ces méthodes.
Expérimenter et documenter les résultats en France.
Soutenir les pionniers qui osent changer de paradigme.
Là où l’agriculture industrielle épuise, la syntropie nourrit. C’est un chemin d’avenir, et il est grand temps d’y prêter attention !
Il existe même des formations en France autour de cet art de préserver l’abondance du vivant et de composer avec : Permaterra , Me Former en Occitanie et bien d’autres en Europe et dans le Monde.
Bien plus qu’un retour à la nature, c’est une agriculture du futur qui nous apporte des solutions concrètes aux changement climatiques actuels, capable de régénérer le vivant tout en nourrissant durablement les populations.
Il est urgent d’ouvrir le débat et d’encourager les recherches, les formations et l’expérimentation de la syntropie en France. C’est une voie d’avenir pour une agriculture plus humaine, plus fertile, et réellement nourricière.
Anaïs Beltran